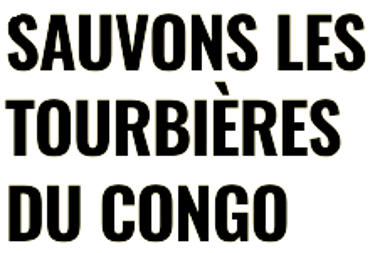Edito.
Pour écouter l'extrait du projet musical autour des tourbières du Congo, cliquez ICI. La réalisation de ce single sollicite l'apport de toutes et de tous soit par un préachat à partir de 10 euros ou par un don à partir d'un euro ou plus. En cliquant sur faire un don, ci-dessous, vous devenez acteur.
Les tourbières du Congo : un bien commun en péril
Le 05 avril 2018, un jeudi soir comme tant d’autres, j’étais assis dans mon fauteuil, attendant le journal télévisé de France 2. Parmi les titres, une annonce retint mon attention : un reportage sur la découverte, au cœur du Congo, de la plus vaste tourbière tropicale du monde.
Cinq minutes plus tard, j’apprenais qu’elle pourrait jouer un rôle crucial dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le journaliste conclut par une phrase qui résonne encore :
« L’enjeu est d’intéresser les habitants de la région, de les transformer en gardiens de la tourbière, car c’est bien une partie de notre avenir qui se joue sur les rives du bassin du Congo. »
Un géant écologique oublié
Quelques clics sur Internet suffirent à me plonger dans une réalité vertigineuse. Ces tourbières, identifiées dès les années 1960 par la NASA, s’étendent à cheval sur les deux Congo : deux tiers en République Démocratique du Congo, un tiers en République du Congo.
Elles couvrent une superficie quatre fois supérieure à celle de la Suisse et contiennent près de 30 milliards de tonnes de carbone, soit l’équivalent de trois années d’émissions mondiales de combustibles fossiles. Une véritable bombe à retardement.
Si une telle découverte avait eu lieu en Europe, elle aurait depuis longtemps été érigée en bien commun de l’humanité. Des programmes éducatifs, des politiques publiques et des financements internationaux auraient été mis en place pour assurer sa protection.
Mais les deux Congo figurent parmi les pays les plus corrompus au monde : 178ᵉ pour Kinshasa, 173ᵉ pour Brazzaville, selon l’indice de perception de la corruption. Autant dire que la confiance internationale est au plus bas. Et sans confiance, pas de financement.
Redonner le pouvoir à la société civile
Cette situation n’est pourtant pas une fatalité. Elle pourrait être contournée si la société civile devenait un acteur majeur de la gestion de ces tourbières. Les pays nordiques montrent la voie : là-bas, l’État coopère étroitement avec les organisations citoyennes dans la préservation de l’environnement.
Mais, est-ce que les pouvoirs publics de part et d’autre du fleuve du Congo accepteront-ils une telle relation ? C’est toute la question. J’ai en mémoire le single de Youssoupha intitulé Denis Mukwege - Grand Congo où il est dit que ceux qui dirigent le Congo n’aiment ni le Congo ni les congolais.
Pourtant, c’est bien d’un partenariat équilibré entre pouvoirs publics et citoyens que dépend l’avenir de ce patrimoine mondial. Il faut donc engager dès maintenant un bras de fer constructif, pour que la société civile devienne un interlocuteur à part entière des bailleurs de fonds internationaux.
La diaspora, un levier d’espoir
Dans une lettre adressée en novembre 2022 à M. Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace, j’écrivais :
« Les tourbières du Congo ne seront à l’abri de toute prédation que si les Congolais des deux rives comprennent que leur sauvegarde conditionne leur survie. »
Cette prise de conscience est essentielle, car 75 % de la population des deux Congo vit avec moins de deux dollars par jour. Elle n’a pas les moyens d’agir seule. L’espoir réside donc aussi dans la diaspora, principalement installée en France et en Belgique.
Ces millions de femmes et d’hommes qui soutiennent leurs familles à distance pourraient devenir un puissant relais de mobilisation écologique, s’ils étaient informés de l’importance de ces tourbières.
Car l’histoire le prouve : c’est toujours la pression citoyenne qui pousse les gouvernements à agir pour le climat.
Un fonds citoyen pour le climat
La solution existe : créer un fonds géré par la société civile pour la sauvegarde des tourbières du Congo. Ce fonds distinguerait clairement ce qui relève de l’État et ce qui dépend du mouvement citoyen, afin d’éviter les dérives bien connues de la “parentocratie” locale.
Les financements seraient orientés vers des projets concrets : autosuffisance alimentaire, mécanisation de l’agriculture, éducation environnementale. L’objectif est simple : intéresser les habitants à leur environnement, leur permettre d’en vivre dignement, et en faire les premiers gardiens de ce trésor écologique.
La restitution des « biens mal acquis » : un financement éthique
Le 20 novembre 2022, le président Emmanuel Macron déclarait sur Twitter :
« À la COP27, la France et l’Europe ont réaffirmé leur engagement pour le climat. Nous avons besoin d’un nouveau pacte financier avec les pays les plus vulnérables. »
Cette déclaration m’a conduit à réaffirmer une proposition formulée quelques mois plus tôt : affecter les sommes issues de la restitution des “biens mal acquis” à la protection des tourbières du Congo.
Les échanges que j’ai eus avec les ministères français concernés laissent entrevoir une ouverture. Transparency International et l’association Sherpa, qui militent de longue date pour une restitution transparente, offrent un cadre solide pour que cette idée devienne réalité.
Encore faut-il que les sociétés civiles congolaise et française travaillent main dans la main pour que cette restitution bénéficie à ceux qu’elle concerne vraiment : les peuples du Congo.
Préserver, c’est vivre
Les tourbières du Congo se sont formées il y a des millénaires, sans l’aide de personne. Elles n’ont pas besoin qu’on les régule, mais qu’on les respecte.
Préserver cet écosystème, c’est préserver une part de notre avenir commun.
Il ne s’agit pas seulement d’un combat pour la nature, mais d’un combat pour la dignité, pour la justice, pour la vie.
Philippe Assompi
Président de l’OPET-BC