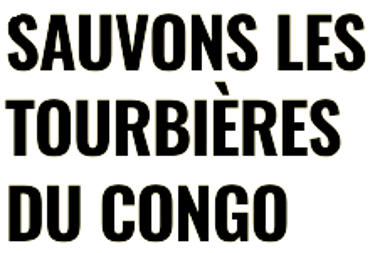Tourbières : de la COP de Paris à la COP30, quel bilan et quelles solutions ?
Dix ans après l’Accord de Paris, la communauté internationale se retrouve à Belém, au Brésil, pour la COP30. Au cœur de l’Amazonie, une question s’impose : qu’avons-nous fait pour protéger les tourbières tropicales, ces zones humides méconnues du grand public mais vitales pour le climat ? Et surtout, comment impliquer durablement les populations dans leur sauvegarde ?
Philippe Assompi
11/3/20254 min read
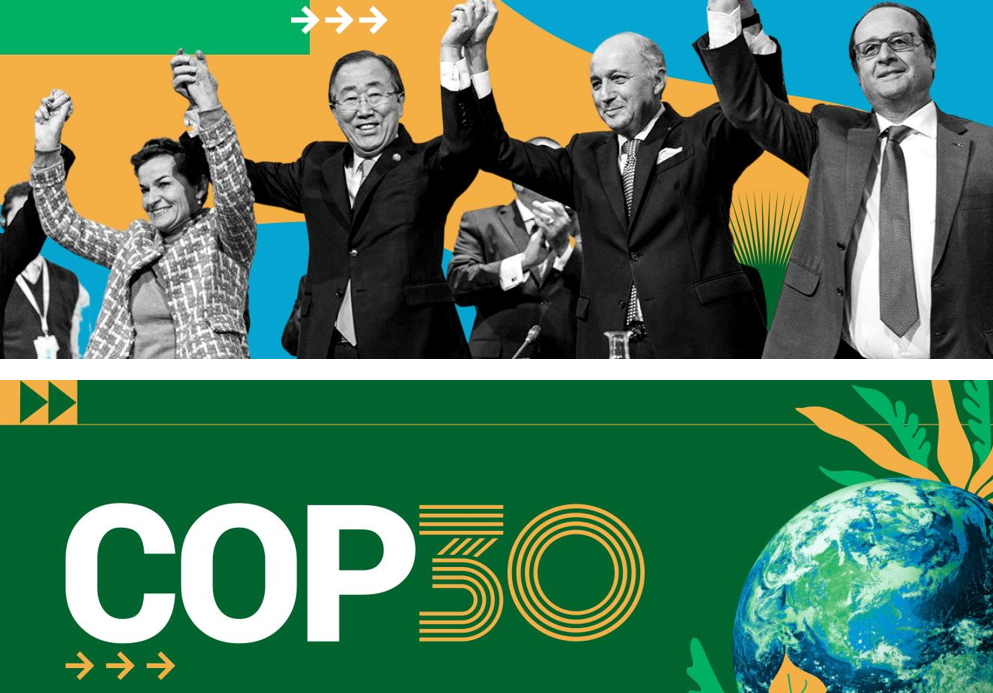

Un trésor naturel millénaire
Les tourbières sont des zones humides formées par l’accumulation lente de végétaux dans des sols gorgés d’eau. Cette matière, devenue tourbe, retient d’immenses quantités de carbone.
Bien qu’elles ne couvrent qu’environ 3 % des terres émergées, elles stockent près d’un tiers du carbone mondial des sols, davantage que toutes les forêts du monde réunies.
Dans le bassin du Congo zen Amazonie ou en Asie du Sud-Est, ces écosystèmes régulent les flux d’eau, abritent une biodiversité unique et jouent un rôle essentiel dans la stabilité du climat.
Mais leur équilibre reste fragile : drainage, incendies, exploitation forestière, projets agricoles ou miniers les menacent directement. Lorsqu’elles sont asséchées, elles libèrent d’énormes quantités de gaz à effet de serre, aggravant la crise climatique.
Un bilan mitigé depuis Paris
Lors de la COP21 à Paris en 2015, les États se sont engagés à contenir le réchauffement en dessous de 1,5 °C. Pourtant, dix ans plus tard, les tourbières demeurent largement absentes des plans climatiques internationaux.
Certes, des programmes internationaux comme la Global Peatlands Initiative du PNUE ou la Convention de Ramsar ont permis de progresser sur la cartographie et la sensibilisation. Mais sur le terrain, les résultats sont faibles sinon inappropriés au regard des enjeux.
Dans le bassin du Congo, qui abrite la plus vaste tourbière tropicale du monde, les feux, l'orpaillage sauvage, la déforestation et la pression économique continuent de dégrader ces milieux. En Amazonie, les zones humides restent encore mal protégées et peu surveillées.
Les scientifiques et les ONG tirent la même conclusion : sans une gouvernance locale forte et transparente, les promesses resteront lettres mortes.
Belém : un tournant pour la planète
La COP30, du 06 au 21 novembre 2025 à Belém, marquera un moment clé. Tenir cette conférence au cœur de l’Amazonie, c’est rappeler que la nature elle-même fait partie de la solution climatique.
De nombreux acteurs plaident pour que la COP de Belém soit celle :
· De l’intégration des tourbières dans les politiques climatiques ;
· Du financement durable pour leur restauration ;
· Et surtout, de la reconnaissance du rôle central des populations locales.
Car ces communautés, souvent les premières affectées par la dégradation des terres, sont aussi les plus légitimes pour protéger ces milieux. Leur implication directe serait un gage d’efficacité et de transparence dans la mise en œuvre des politiques environnementales.
L’éducation et la société civile, remparts contre la corruption
Les tourbières tropicales se sont formées seules au fil des millénaires, sans intervention humaine. Leur survie dépend désormais de notre capacité à vivre en équilibre avec elles.
Pour cela, l’éducation environnementale est un outil fondamental : elle permet aux communautés locales de comprendre, de préserver et de transmettre leurs savoirs.
Mais elle joue un autre rôle, souvent sous-estimé : celui de barrière naturelle contre la corruption endémique.
Dans plusieurs pays d’Afrique centrale, notamment les deux Congo, la gestion des ressources naturelles est trop souvent minée par des détournements, un manque de transparence et des intérêts économiques à court terme.
En impliquant directement les populations, on contourne ce système. Dans plusieurs pays d’Afrique centrale, notamment les deux Congo, la gestion des ressources naturelles reste trop souvent entravée par des détournements, un manque de transparence et des intérêts économiques à court terme.
Face à cette réalité, l’Organisation pour la Protection, la Préservation et la Promotion de l’Écosystème des Tourbières du Bassin du Congo plaide pour une participation active de la société civile dans la gouvernance environnementale. Car seule une gestion ouverte aux communautés locales, peut garantir une protection durable et échapper aux logiques de corruption ou de prédation. Les habitants deviennent acteurs et témoins de la gestion de leurs territoires : ils contrôlent l’usage des fonds, participent à la surveillance environnementale et exigent des comptes. Ce mode de gouvernance réduit les risques de corruption tout en renforçant la légitimité des actions locales.
Former les jeunes, impliquer les associations, les universités, mobiliser les médias communautaires : tout cela permet de construire un garde-fou citoyen. Ainsi, la préservation des tourbières ne dépend pas seulement des institutions, mais d’une culture collective transmise de génération en génération.
Des solutions concrètes à portée de main
Préserver les tourbières, ce n’est pas bloquer le développement : c’est protéger un capital naturel commun.
Plusieurs initiatives montrent la voie :
· Promouvoir une agriculture adaptée aux zones humides, sans drainage ;
· Développer un écotourisme responsable générateur de revenus locaux ;
· Créer des zones protégées cogérées avec les communautés ;
· Soutenir la recherche scientifique locale et les programmes de formation environnementale.
Ces approches, déjà expérimentées au Congo et en Amazonie, prouvent qu’on peut concilier protection, justice sociale et développement.
Dix ans après la COP de Paris, la conférence de Belém représente un moment charnière pour redonner le pouvoir à la nature et aux peuples. Il ne s’agit pas seulement de dresser un bilan, mais d’engager une nouvelle voie : celle de la responsabilité partagée entre États, scientifiques et citoyens. Les tourbières n’ont pas besoin d’un sauveur politique, mais d’une humanité consciente et éduquée. Impliquer les populations, c’est non seulement assurer la survie de ces écosystèmes millénaires, mais aussi rétablir la confiance là où la corruption a trop souvent trahi les promesses. Sauver les tourbières, c’est sauver à la fois le climat, la dignité et l’avenir des peuples qui en dépendent.
Philippe Assompi
Président de l’OPET-BC