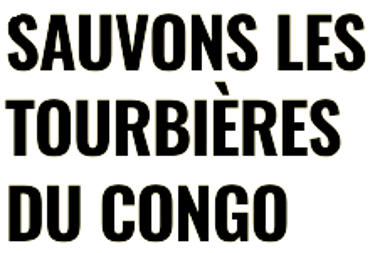Et si la mort avait un visage ? Ce que l’invisible coût du carbone aurait changé dans la lutte contre le climat
Le changement climatique, bien que prouvé scientifiquement et perceptible à travers des phénomènes extrêmes, reste pour beaucoup une menace abstraite. Invisible, diffus, parfois lent, il échappe à la perception immédiate. Mais imaginons un instant : et si la mort se montrait ? Et si le carbone, principal responsable du réchauffement climatique, se voyait ? Cette simple hypothèse soulève une question essentielle : la perception humaine des dangers invisibles serait-elle différente si leurs conséquences étaient concrètes, visuelles, tangibles ? Plongeons dans cette fiction pour interroger notre rapport à l’environnement, à la responsabilité collective, et aux signaux d’alerte que nous choisissons encore trop souvent d’ignorer.
Philippe Assompi
8/28/20253 min read


Le carbone, ce tueur invisible
Le dioxyde de carbone (CO₂) est un gaz inodore, incolore, insaisissable. C’est précisément cette invisibilité qui a permis à l'humanité de l’émettre sans gêne pendant des décennies. Chaque voiture qui roule, chaque usine qui fume, chaque avion qui décolle, libère des quantités massives de CO₂ dans l’atmosphère. Pourtant, la majorité des gens n’y voient rien, littéralement. Si le CO₂ était visible, ne serait-ce que sous forme de brume noire ou de nuage épais, serions-nous aussi tolérants ? Imaginons un monde où chaque litre d’essence brûlé laisserait derrière lui une traînée sombre, permanente. Les villes seraient noyées dans un brouillard dense, les océans noircis, et chaque respiration deviendrait un rappel visuel du prix à payer.
La mort personnifiée : une présence trop évidente pour être ignorée
Maintenant, ajoutons un autre élément à ce scénario : et si la mort elle-même se montrait à chaque fois qu’une action humaine contribue à la destruction de l’environnement ? Un visage pâle apparaissant près des centrales à charbon, des ombres suivant les camions de transport massif, des silhouettes noires planant au-dessus des déforestations illégales. Chaque geste nocif pour la planète serait accompagné d’un avertissement visuel implacable. La mort ne serait plus une abstraction future, mais une compagne constante de nos excès.
Les sociétés, confrontées à une telle incarnation du danger, n’auraient sans doute pas pu détourner le regard aussi facilement. Les politiques climatiques, aujourd’hui trop souvent freinées par des intérêts économiques à court terme, auraient peut-être pris des tournures plus radicales dès les premières alertes scientifiques.
La psychologie de l’urgence : pourquoi l’homme réagit à ce qu’il voit
Le cerveau humain est programmé pour réagir aux menaces immédiates, visibles et concrètes. Un feu de forêt, un ouragan, une inondation : ces événements déclenchent des réactions instinctives de survie. Le changement climatique, en revanche, agit de manière progressive. Il s'étale sur des décennies, ses signes sont diffus, souvent interprétés comme des anomalies ponctuelles. C’est là que l’invisibilité du problème devient son meilleur camouflage.
Si le carbone avait une couleur, une odeur ou une forme visible, la conscience collective se serait probablement éveillée plus tôt. Les décisions politiques auraient été plus rapides, les comportements individuels plus responsables. Voir le mal, c’est le reconnaître. Le reconnaître, c’est commencer à le combattre.
Quand la fiction rejoint la réalité
Ce scénario n’est pas si éloigné de certaines tentatives réelles de rendre le changement climatique plus "visible". Des artistes, des scientifiques et des activistes cherchent déjà à donner une forme perceptible à l’invisible. Des capteurs de CO₂ qui changent de couleur, des installations artistiques qui matérialisent la montée des eaux, des cartes interactives qui montrent l’évolution des températures, tout cela pour dire : « Regardez ce que vous ne voyez pas. »
De plus, les conséquences de nos émissions deviennent peu à peu tangibles. Des records de chaleur tuent des milliers de personnes, des villes suffoquent, des territoires deviennent inhabitables. La mort est là, même si elle ne porte pas encore de visage.
Le cinéma comme révélateur de l’invisible
Et si ce rôle de rendre visible l’invisible revenait justement aux créateurs d’images, aux conteurs, aux cinéastes ? Le cinéma a toujours su donner un visage à l’abstraction : la peur, l’amour, le temps, la mémoire. Pourquoi ne pas incarner aussi le carbone, la mort climatique, les ombres de nos choix collectifs ? Une telle représentation, portée par la puissance émotionnelle du septième art, pourrait frapper les consciences bien plus que des chiffres ou des graphiques. Aux réalisateurs, scénaristes et producteurs de s’emparer de cette matière pour provoquer une véritable secousse culturelle, en créant des récits qui dépassent l’information et suscitent l’action. Car l’imaginaire partagé a souvent précédé les grandes révolutions de société.
Une prise de conscience à faire naître ...
Imaginer un monde où le carbone se voit et où la mort se montre n’est pas seulement un exercice littéraire. C’est un appel à réfléchir à notre perception du réel. Le défi du changement climatique est autant scientifique que psychologique. Pour agir, il faut croire. Pour croire, il faut voir. À défaut d’avoir un carbone noir ou une mort visible, il nous revient, collectivement, de rendre ces menaces plus palpables : par l’éducation, l’art, la science, et surtout, par l’écoute des faits. Car même invisibles, les dangers sont là et ils ne cessent de grandir.
Philippe Assompi
Président de l’OPET-BC